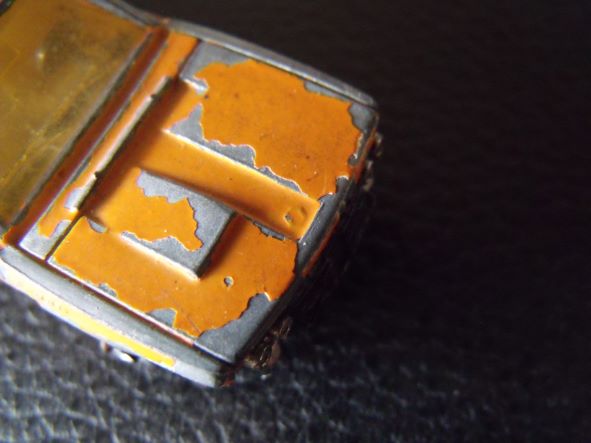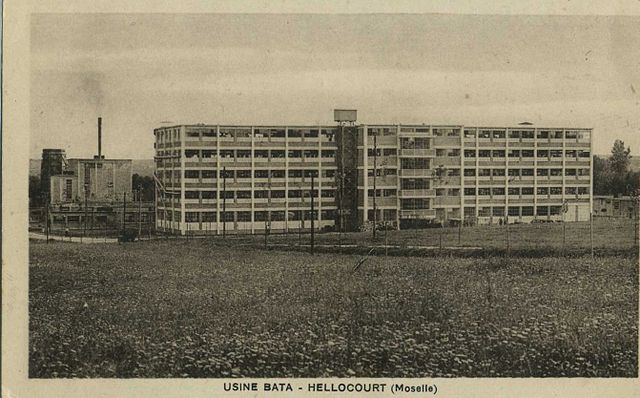(une approche amusée de l’histoire d’entreprise)
Audaciter calomniare semper aliquid haeret. « Calomniez audacieusement, il en restera toujours quelque chose ». Ce proverbe latin semble particulièrement convenir à la marque Reliant, dont l’image de marque est durablement écornée. Même au delà des îles britanniques ou du cercle restreint des amateurs de curiosités automobiles. Et pourtant…

Une célèbre inconnue
Constructeur britannique établi en 1935, Reliant s’est progressivement spécialisé dans la construction de petits véhicules en fibre de verre à trois roues. Une niche fiscale et légale, plus qu’un réel engouement pour cette curieuse architecture, explique la persistance d’un marché pour ces véhicules. A l’instar des voitures sans permis en France.
Comme les voiturettes dans l’Hexagone, les productions de Reliant ont rapidement souffert d’une image de véhicules pour personnes âgées ou détenteurs d’un permis de seconde zone. A cela s’ajoutaient quelques doutes sur sur la stabilité en courbe de ces curieux engins.
Ceux pour qui le nom Reliant n’évoque toujours rien connaissent probablement malgré tout ses productions.
Dans son show télévisé, Mr Bean, de 1990 à 1995, Rowan Atkinson a fait d’une Reliant un personnage récurrent. Au volant de sa Mini, le terrible Bean affronte à de multiples reprises une Reliant Regal Supervan bleue finissant presque invariablement sur le côté.
Les plus jeunes et les amateurs d’automobiles ont découvert Reliant et sa triste réputation avec l’émission de divertissement Top Gear. Dans un épisode de 2010 devenu culte, l’animateur Jeremy Clarkson procède à l’essai d’une Reliant Robin dans les rues de Sheffield. Sans surprise, la voiture se retourne tout au long de l’essai.
Pourquoi laver l’honneur de Reliant ?
Contrairement aux propriétaires de ces trois-roues, la marque Reliant qui a cessé de produire des véhicules en 2001 ne devrait guère souffrir de ces sarcasmes.
Oui mais voilà, Reliant n’est pas morte. Elle est désormais spécialisée dans la vente de pièces détachées pour ses anciennes productions.
Or les prestigieuses et défuntes ou mourantes marques d’Outre-Manche se sont signalées ces dernières années par une formidable capacité à renaître d’entre les morts : MG, Mini, Norton et Triumph par exemple.
Si l’envie venait à des investisseurs de relancer la marque, comment un historien d’entreprise pourrait-il alors contribuer à restaurer l’image de la très bancale Reliant ?
Tout d’abord en rappelant que les mythiques cascades de Clarkson sont le fruit d’un sabotage volontaire. L’équipe de production, pour s’assurer de spectaculaires pertes d’adhérence avait en effet, selon les propres dires du pilote en 2016, modifié le différentiel.
Cela ne suffira peut-être pas à rassurer d’éventuels clients sur la stabilité de cette solution technique…
Nous rappellerons alors que Reliant a également construit des années 1960 au milieu des années 1990 de petit coupés et cabriolets artisanaux dans la plus pure tradition britannique : la Sabre et les différents avatars de la Scimitar. Fibre de verres et moteur de grande série, comme Lotus. Entreprise fondée avant la guerre comme Morgan.
De plus, dans une monarchie millénaire, il n’est sans doute pas inutile de mentionner que la princesse Anne appréciait particulièrement la Scimitar. A la GTE offerte par ses royaux parents pour ses 20 ans ont succédé pas moins de sept autres exemplaires.
La voiture d’une lointaine galaxie
Enfin, si toutefois Reliant s’obstinait à vouloir renouer avec ses three-wheelers, alors devrait être mis en avant un ultime argument imparable. Une bonne partie des enfants de la galaxie a un jour rêvé de piloter une Reliant… sans le savoir.
Ogle Design a dessiné plusieurs modèles pour Reliant. La fameuse Scimitar, la moins glorieuse Robin et l’étrange Bond Bug. Cette dernière était une tentative de toucher un public plus jeune avec un dessin plus futuriste et sportif (pour l’époque).

Au début des années 1970, Ogle Design est contactée par Lucasfilm pour construire le Landspeeder de Luke Skywalker dans le premier volet (mais l’épisode IV) de Star Wars. L’équipe va justement choisir le châssis à trois roues de la Bond Bug.

La Force des Jedi permettrait elle à ces trois roues de ne plus jamais se renverser ? Et à la réputation de Reliant de se relever ?